La pédagogie : bien plus qu’une méthode, une réflexion en action
La pédagogie ne se réduit ni à une méthode, ni à une technique : elle est une réflexion en action, un questionnement permanent sur la transmission, l’apprentissage et les relations humaines. En animation, elle engage une mise en cohérence entre valeurs et pratiques, faisant de chaque choix éducatif un acte politique et une forme de résistance.

Définition
Pédagogie (nom féminin)
Général – Ensemble de méthodes permettant l’éducation, l’apprentissage ou l’instruction des enfants, des jeunes et des adultes.
Animation – Ensemble d’outils, de méthodes ou d’organisations permettant de définir et de construire les manières d’être en relation avec les enfants, de jouer avec eux ou de faire vivre la vie quotidienne. Dans l’animation, les pédagogies sont actives et issues de l’éducation nouvelle.
Ces deux définitions réduisent la pédagogie à une sorte de catalogue de techniques concrètes qui traduisent les idées, finalités ou idéologies qui guident l’action. Pour Jean Houssaye, la pédagogie est bien plus que cela, il parle alors d’enveloppement mutuel et dialectique de la théorie et de la pratique par la même personne, sur la même personne. La pédagogie serait une action et une réflexion en même temps, portées par une même personne : le·la pédagogue. Pour faire de la pédagogie, il ne s’agit pas uniquement de faire, de dire, de reproduire ou de reprendre, il s’agit de penser son action, de la mettre en place, de la réfléchir, de l’écrire, de la discuter (notamment avec les personnes concernées), puis de recommencer en sachant une chose, ce qui marche aujourd’hui ne marchera pas demain et à ce titre la pédagogie n’est pas une science reproductible.
Le chercheur et pédagogue Philippe Meirieu dit que la pédagogie est entre le dire et le faire. Elle se situe donc dans cet espace complexe qui lui vaut d’être critiqué en permanence, entre la science qui ne se trompe pas et la pratique qui est l’action d’un moment. La pédagogie en animation, n’est ni l’art de tenir les enfants, ni l’action de faire jouer tout un groupe, ni la technique permettant de faire manger des épinards aux enfants, ni l’objectif qui permet de rendre éducatif un poule-renard-vipère… La pédagogie est une pratique réflexive et une réflexion en pratique qui met en cohérence valeurs et actions, qui permet de transmettre et de faire vivre des valeurs qui dépassent l’action menée. Cette réflexion/pratique est écrite et débattue collectivement. Les valeurs sont nommées et définies, les savoirs scientifiques, pratiques et expérientiels sont mobilisés.
La pédagogie peut se définir comme la mise au travail concomitante des valeurs, des savoirs et des pratiques par les mêmes personnes, dans un même lieu, au même moment. L’animateur·ice d’ACM peut donc être pédagogue, s’il écrit et échange. Les pédagogues portent en eux les tensions inéluctables entre théorie et pratique, entre valeur et réalité, entre leurs souhaits et les possibilités des enfants/jeunes, entre facilité de la reproduction et complexité des situations, entre désir sur l’autre et désir de l’autre, etc.
Analyse
La pédagogie, ce n'est pas…
La pédagogie n’est pas une science, elle n’est pas ou plus enseignée à l’université, dans les écoles du travail social ou dans les formations à l’animation. La pédagogie n’est pas un art, celui de savoir faire comprendre à des personnes réfractaires ou en difficulté des notions complexes ou difficiles. La pédagogie n’est un outil de communication permettant de convaincre le « gaulois réfractaire » que la décision prise à sa place est bonne pour lui. La pédagogie n’est pas une technique permettant d’obliger dans la douceur un enfant à faire quelque chose qu’il ne veut pas. La pédagogie n’est pas une pseudo-science qui viendrait remplacer les savoirs théoriques et qui permettrait de s’extraire des sciences. La pédagogie n’est pas une relation de domination qui permet de décider de tout pour les enfants encadrés. La pédagogie n’est pas… Mais qu’est-elle alors ?
On pourrait demander à l’intelligence artificielle (IA) de nous en donner une définition… Mais cet exercice est vain et illusoire tant l’IA est incapable de comprendre ce qui fait la force même de la pédagogie : la relation humaine. Tout ce que n’est pas la pédagogie sont les arguments qui sont donnés par les opposants à la pédagogie pour la détruire, puisqu’elle n’est pas… elle peut être détruite. Les opposants ont même fait de la pédagogie un « isme », le « pédagogisme », comme les mêmes ont inventé le « droit-de-l’hommisme » ou le « wokisme ».
La pédagogie est politique
Il y a une seule chose sur laquelle ils ne se trompent pas : la pédagogie est politique, c’est-à-dire qu’elle concerne la société dans son ensemble. La pédagogie s’intéresse à comment apprendre, comment transmettre, comment faire vivre, comment organiser, comment construire des relations, comment accompagner, comment faire attention ou prendre soin, la pédagogie va chercher à mettre en cohérence les valeurs et les grandes idées que nous partageons avec les pratiques du quotidien, les actions que nous menons, les manières dont nous sommes en relation et avec les personnes concernées par ces actions ou pratiques. Alors oui, la pédagogie est politique.
Chaque courant politique défend des valeurs et tente de les traduire au quotidien. Les pédagogies virilistes, brutales et autoritaires existent, elles sont écrites et portées par des mouvements, des écoles, des institutions… L’affaire de Bétharram en est le dernier exemple médiatique. Ce même courant défend le Service national universel, les séjours de rupture, le scoutisme non-mixte, les internats d’excellence, etc. Ces pédagogies ne sont ni les seules, ni les meilleures, ni celles qui fonctionnent, ni une évidence, ni rien de tout cela : elles sont la traduction d’idées sur ce que doivent être l’apprentissage, puis la société. Regarde la pédagogie que tu pratiques, je te dirai ce que tu penses pour la société.
Et dans l'animation ?
En animation, le résultat est le même. Il suffit de regarder le fonctionnement, l’organisation ou les déroulés des actions d’un accueil collectif de mineurs pour comprendre ce que veulent les adultes pour les enfants et donc pour la société à venir. Que penser lorsqu’on regarde un accueil de loisirs où tout est imposé, contraint, minuté, où les enfants sont réduits à suivre des groupes, où les adultes crient et ordonnent ? Comment ne pas voir dans ces fonctionnements, ce que Trump, Poutine, Orban mettent en place (certes à un autre niveau) dans leur pays ? Les encadrants de ces centres se rendent-ils compte que ce qu’ils produisent dans leurs ACM fait le lit de la montée des individualismes, de la séparation des milieux sociaux, des discriminations et des violences ? Sans doute de bonne foi, ces encadrants pensent aider ou éduquer les enfants, mais vers quoi ? quelle finalité ? La pédagogie se joue pourtant dans ces dernières questions. Reproduire un outil, une pratique qui marche, une manière que l’on a toujours faite, une façon que l’on a connu enfant, ne peut avoir de sens sans réflexion sur ses finalités. À défaut, chacun basculera vers le modèle colonial… celui que nous avons tous connu, vécu ou subi.
Ce modèle pédagogique, défini et nommé à dessein par Jean Houssaye, se caractérise par : la répartition des enfants par groupes d'âge homogènes, l’organisation des enfants en grands groupes pour les activités et en petits groupes pour la vie quotidienne, la possibilité pour les enfants de choisir dans une palette d'activités dirigées et proposées par les animateur·ices, et un couchage non-mixte. Ce modèle s’appuie sur les notions de besoin et de dynamique des groupes, et les idées de l’Éducation nouvelle. Il est hégémonique et immuable depuis des décennies, tant la pédagogie a disparu de nos accueils collectifs de mineurs mais aussi et surtout des formations à l’animation volontaire.
La pédagogie, une action de résistance
Chaque animateur·ice qui se rend compte qu’entre ses pratiques et ses valeurs il existe un écart, basculerait dans la pédagogie, entrerait dans une réflexion pédagogique lui permettant de (re)trouver de la cohérence. Une cohérence temporaire, une cohérence qui serait de nouveau questionnée par un enfant, un jeune, un collègue, un parent… et ainsi de suite de manière inévitable. La pédagogie est un processus sans fin, un questionnement sans réponse, des pratiques qui marchent et ratent en même-temps, des discussions et des écrits qui permettent de penser et d’accompagner, d’aider ou jouer avec des enfants.
Au regard de ces éléments, on comprend mieux pourquoi la pédagogie est critiquée ou minorée. Par son hybridité, elle remet en question le pouvoir de ceux et celles qui détiennent les savoirs théoriques, elle minore l’autorité de celui qui sait faire, elle questionne les idéologies en s’appuyant sur le réel, elle sape l’organisation de notre monde (aux chefs la pensée et la réflexion et aux exécutants la pratique, le contact avec les personnes), mais la pédagogie remet au cœur de l’action les praticien·ne·s, les tatonneur·e·s, les personnes qui cherchent dans le boue du réel, dans la souffrance des situations, dans le rapport humain, la grandeur de chaque personne quelle qu’elle soit. À ce titre, la pédagogie est et sera toujours une action de résistance… encore plus aujourd’hui où il faut résister contre les populismes, le fascisme, les extrémismes et contre les dérives scientistes, sectaires, idéologiques, marchandes et de repli de nos collègues en ACM.
Pour aller plus loin
- À quoi sert la pédagogie ?, Philippe Meirieu
- Les courants pédagogiques en action, Anim’ Magazine (septembre/octobre 2008)
- Spécial pédagogies alternatives – Le Journal de l’Animation n° 208 (avril 2020)
- 16 ressources autour des pédagogies alternatives, Le Journal de l’Animation (avril 2020)
- Révolution école 1918-1939, documentaire réalisé par Joanna Grudzińska, écrit par Léa Todorov, Joanna Grudzińska, Laurent Roth, François Prodromidès. Ce documentaire raconte la naissance et l’émergence de l’Education nouvelle.
- Animateur·trice en pratique : enjeux pédagogiques et postures professionnelles, Jean-Michel Bocquet, Cahiers de l’action, n° 62 (2024)
- Manifeste pour les pédagogues, Jean Houssaye, ESF (2002)
- La pédagogie entre le dire et le faire, Meirieu Philippe, ESF (2007)
- Former à la pédagogie, est-ce bien raisonnable ?, Jean Houssaye, Carnets de recherche sur la formation (mars 2018)
- Titre :
- La pédagogie : bien plus qu’une méthode, une réflexion en action
- Auteur :
- Jean-Michel Bocquet
- Publication :
- 28 avril 2025
- Source :
- https://www.jdanimation.fr/node/2759
- Droits :
- © Martin Média / Le Journal de l'Animation

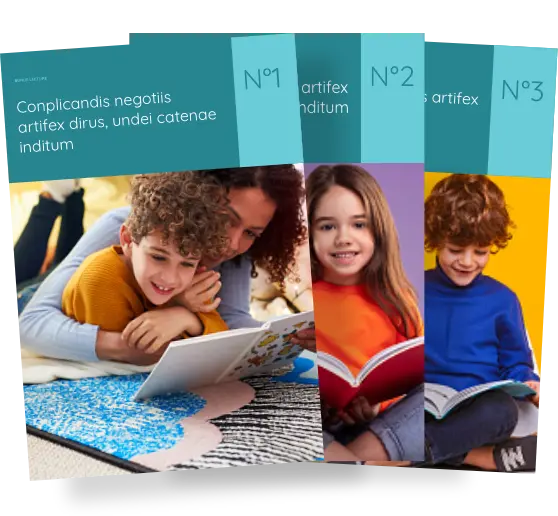
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.